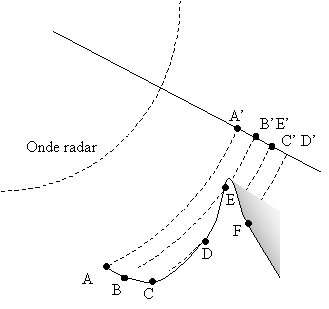
Le mot radar est le sigle de l'expression américaine RAdio Detection And Ranging, c'est à dire détection par radio et mesure de la distance. Jusqu'à la moitié des années 40 les Anglais utilisaient le terme de radiolocation et les Français celui de détection électromagnétique (DEM). C'est un système qui illumine une portion de l’espace avec une onde électromagnétique et reçoit les ondes réfléchies par les objets qui s’y trouvent. Ces ondes peuvent caractériser les objets: que ce soit leur position horizontale, leur altitude, leur vitesse et parfois leur forme.
En 1886, Heinrich Hertz démontra la similitude entre ondes lumineuses et ondes «radio», toutes deux électromagnétiques. Leur différence essentielle est que la longueur d’onde de ces dernières est beaucoup plus grande que celle des ondes lumineuses. Hertz montra que les ondes «radio» pouvaient, elles aussi, être réfléchies par les corps métalliques et diélectriques. Dès 1904, l’Allemand Christian Hülsmeyer décrivait un «appareil de projection et de réception d’ondes hertziennes pour donner l’alarme en présence d’un corps métallique tel qu’un navire ou un train situé dans le faisceau du projecteur». Cette possibilité était vérifiée expérimentalement de façon plus ou moins complète de 1922 à 1927 par un certain nombre de chercheurs. En juin 1930, l’Américain L. A. Hyland obtint une détection accidentelle d’un avion passant dans un faisceau d’ondes «radio» de 9 mètres de longueur d’onde. Dès lors, le Naval Research Laboratory (N.R.L.) expérimenta de 1930 à 1934 un premier système de «détection d’objets par radio» en ondes métriques (environ 5 m de longueur d’onde) permettant des détections d’avions distants de quelque 80 kilomètres.
Un radar est essentiellement constitué par un émetteur, une antenne et un récepteur muni d’un système de visualisation, ces deux éléments ne faisant la plupart du temps qu'un seul.
L’émetteur lance à intervalles réguliers (par exemple, toutes les milli-secondes) des signaux très brefs (par exemple, de 1 microseconde de durée), à une fréquence donnée (correspondant à une longueur d’onde variant, selon les applications, entre quelques mètres et quelques millimètres). Le signal n’est pas émis dans toutes les directions: l’antenne du radar, qui agit comme un projecteur, concentre l’émission dans une zone très étroite de l’espace, soit dans un cône de faible ouverture horizontale (de l’ordre de 1 degré), soit dans un cône de faible ouverture verticale (également de l’ordre de 1 degré). C’est ainsi que sont illuminées, d’autant plus faiblement qu’elles sont d'autant plus loin, les cibles situées dans le champ de l’antenne. Ces cibles réfléchissent les signaux reçus, et l’antenne capte les échos avec un décalage par rapport à l’émission, décalage d’autant plus grand que les cibles sont d'autant plus lointaines.
Si deux cibles sont à égale distance de l'émetteur, le signal met le même temps pour parcourir cette distance et les deux cibles sont donc confondues pour le récepteur : le radar travaille en distance.
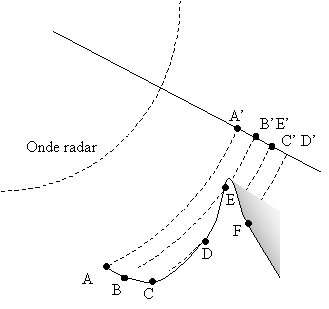
Ondes radar, David Petit - Irit
Avec un radar classique, on atteint des portées de 500 kilomètres sur des avions militaires, et l’on utilise pour ce faire des antennes dont la surface peut atteindre 100 mètres carrés, associées à des émetteurs produisant des signaux dont la puissance atteint 20 mégawatts.
Pour plus d'information, cliquer ici. Nous y présentons les ondes depuis l'apparition du concept grâce à Huygens jusqu'à sa formalisation moderne par les complexes (amplitude et phase)
Amplitude
L'amplitude dépend du coefficient de rétrodiffusion de la cible dans les conditions d'observation. Ce coefficient est fonction de nombreuses caractéristiques (pente locale, humidité du sol, ...), et est aléatoire. Le coefficient de rétrodiffusion s0 peut être exprimé en fonction de l'amplitude A et d'un coefficient de normalisation k:
s0=20log(kA)
| s0 en décibel (dB) | Type de surface |
| +50 | Cibles ponctuelles, navires, véhicules |
| +20 | Zones urbaines |
| 0 | Surface plane |
| -10 | Forêt, végétation |
| -15 | Herbe rase |
| -22 | Goudron, béton |
Phase
La phase du signal reçu est la somme de six phases:
ftotal = ftrajet + fmétéo + fconstruction + frétrodiffusion + finstrumentale + fbruit
ftrajet , déphasage lié à la distance parcourue par l'onde.
fmétéo , déphasage produit par les conditions atmosphériques.
fconstruction , déphasage du à la somme des phases de trajet interne au pixel.
frétrodiffusion , déphasage introduit au moment de l'interaction avec l'élément de surface.
finstrumentale , déphasage produit par le système électronique d'émission et de réception.
fbruit , déphasage produit par l'instrumentation et les procédés d'acquisition.
L'information de phase n'est pas directement exploitable, toutefois c'est une riche source d'information qui nous servira dans notre traitement d'images. Nous n'utiliserons que la phase de trajet en supposant les cinq autres constantes.
Image radar
Une image radar est alors composée de deux images, une d'amplitude et une de phase.
SLAR est le sigle de l'expression Side Looking Airborne Radar, c'est à dire radar aéroporté à vision latérale. Le temps de retour de l'onde fournit toujours la position en distance des éléments de la scène. C'est pourquoi, la visée se fait latéralement car les points situés à la verticale de l'antenne sont tous quasiment à la même distance et donc indiscernables.
Régulièrement, le radar émet un train d'onde qui correspond alors à une ligne image.
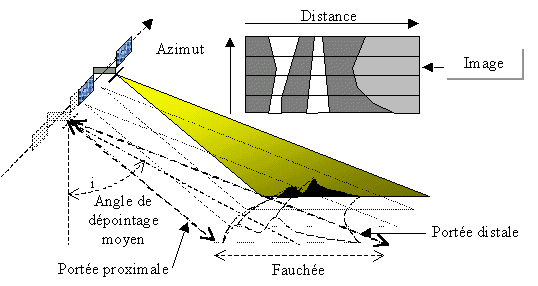
Principe du SLAR, David Petit - Irit